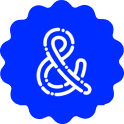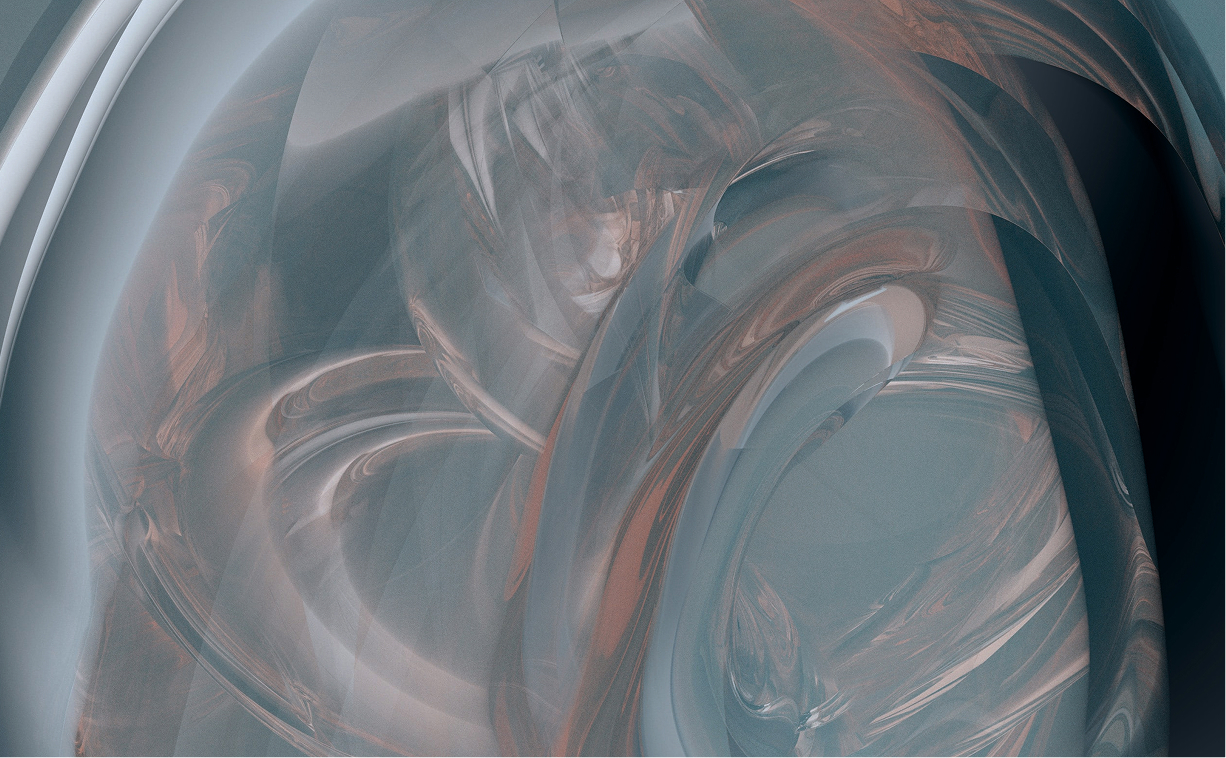J’ai souvent contemplé les ténèbres et leurs promesses de réconfort.
À la lumière, tout est mis à nu : nos apparences, nos sentiments, nos efforts incomplets et nos échecs inévitables. On ne peut rien cacher, on ne peut rien substituer aux regards. Nous n’avons d’autres choix que de divulguer au monde entier notre vulgaire carcasse. Nos contours deviennent obscènement nets et distincts, et on ne peut plus se fondre dans la masse informe de l’obscurité.
Pour exister sans contradictions, il faut être magicien — exécuter quelques subtils tours de passe-passe. Du genre de ceux qui nous rendent plus sympathiques et fonctionnels en société, parce qu’ils nous permettent de dérober aux yeux des autres notre véritable essence. Mais aucune magie n’est réalisable sous les feux incandescents des projecteurs. Aucune absence n’est possible. À la lumière, tous les fantômes disparaissent.
Ma tante en avait croisé plein, des fantômes. Dans ses dernières années, elle racontait sans cesse la même histoire qu’elle avait auparavant toujours tu, de peur d’être condamnée à l’asile. Très jeune déjà elle était affligée par des maux qui pétrifiaient son petit corps souffreteux. Il n’y avait à l’époque pas de remède hors l’alitement. La pauvre devait supporter en silence la douleur des nerfs de ses mains paralysées qui s’embrasaient.
Chaque soir, pendant des semaines voire des mois, alors qu’elle s’asseyait dans son lit d’enfant sage, elle était visitée par les spectres de ses aïeux, et des figures vaporeuses dansaient devant elle, dans les ombres fugaces projetées par la lumière vacillante de sa petite lampe de chevet.
Sa manière de narrer son expérience était toujours la même, si bien qu’aujourd’hui je pourrai la raconter mot pour mot. C’était somme toute une histoire de fantômes classique, semblable à celles des vieux romans d’épouvante, à ceci près que ce qui nous glaçait le sang n’était pas à proprement parler sa description détaillée de chacune des apparitions, mais plutôt la posture qu’elle adoptait malgré elle, comme sous emprise, à chaque nouvelle répétition.
Elle se figeait peu à peu, ses maigres muscles se raidissant dans des contractures improbables qui faisaient apparaître ses os saillants sur son corps décharné ; ses yeux mi-clos prenaient une apparence plus laiteuse encore que d’ordinaire et sa gorge se nouait, comme étranglée par sa propre langue, dans un discours qui devenait de moins en moins intelligible comme si son corps la censurait lui-même. Jusqu’à la délivrance du point final de l’histoire : « un jour ils ne sont plus apparus, et je me suis retrouvée complètement seule. »
Aucune phrase, aucun mot de son discours ne pouvait jeter le doute sur l’existence d’une vie après la mort : tout tendait à prouver que les fantômes existaient, qu’ils étaient aussi réels et palpables que la chaleur des rayons du soleil, aussi froids et insaisissables que la condensation de nos soupirs lors d’une matinée fraîche. Certes, les goules disparaissent à la lumière de l’aube, mais ils restent là.
C’est terrifiant, un fantôme.
Terrifiant parce qu’il témoigne d’un après immaîtrisable. L’histoire de mes ancêtres visitant une petite fille à chaque nouvelle nuit me terrorisait, tant cela ressemblait à une peine à purger absurde. Une condamnation à l’errance dans un monde qui ne tourne plus autour de soi. Un monde qui existe, qui continue d’exister, sans nous, malgré nous. Un flottement d’apparence, un ersatz du passé, un reflet que tout traverse impunément, comme pour nous révéler que tout, partout, tout le temps, nous a toujours traversé sans le moindre remords.
Existe-t-il une seule image positive du fantôme ? Même Casper, malgré sa bonhommie apparente, est pâle, incolore et sans odeur. La désincarnation incarnée. Il est sympathique mais ça ne le rend pas moins monstrueux d’avoir perdu tout ou presque de son apparence humaine. Et l’ensemble des autres spectres lui sont semblables par le constat implacable de leur inexistence et de leur informité.
Tout dans le fantôme rappelle qu’il est d’abord et avant tout un mort, un mort qui subsiste. Il reste un cadavre, dont la seule pudeur est l’absence de chair qui nous épargne le dégoût de sa décomposition. Ils n’échapperont pourtant jamais au lien logique de leur genèse : s’ils sont là, parmi nous, perméables, tout nous rappelle que quelque part leur matière originelle est en putréfaction, éclatée, offerte aux vers et autres insectes.
Sommes-nous voués à contempler nous-mêmes, impuissants, la dégradation de ce que nous fûmes, au milieu du supposé confort de boîtes aseptisées ? Un revenant a t-il encore conscience du sacrifice cauchemardesque que son existence implique ? Et comment même continue-t-il d’exister avec tant d’absence ?
C’est terrifiant, un fantôme. Jamais je ne voudrais en devenir un. Jamais je ne voudrais perdurer à tout prix, au prix de mon corps, de ma chair, de mes os, de mes yeux. Jamais je ne souhaiterais subir l’immortalité, observer la dilatation du temps sans pouvoir agir, être impuissant et voir vivre puis mourir des êtres chers que j’aurais côtoyé malgré moi, malgré eux.
Ma vieille tante quant à elle ne semblait pas traumatisée par la présence de ses hôtes muets. Oui, leurs silhouettes changeantes n’évoquaient rien d’autre que la mort, elle était la première à l’admettre. Même leur absence de parfum convoquait en elle des images de morgue ancienne, où ses aïeux avaient sans doute été sommairement embaumés. Il y avait l’exception de quelques rares instants où, selon qu’elle dodelinait ou non sa petite tête d’enfant, elle semblait voir s’imprimer sur ce brouillard des souvenirs en forme de visages. Mais jamais elle n’exprimait l’effroi, l’angoisse ou le dégoût. Son histoire, bien que terrible sous tout aspect, ne transpirait que le regret et le manque.
« Je me suis retrouvée complètement seule. » Pourtant il n’y avait qu’elle dans la pièce, il n’y avait qu’elle dans son lit, mais c’est seulement quand les spectres ont cessé leurs apparitions, qu’elle a pleinement pris conscience de son irrémédiable solitude. Tant qu’ils flottaient autour d’elle, tant qu’ils l’entouraient de leurs bras vaporeux, les limites du monde se projetaient au-delà d’elle-même, au-delà de sa chambre, au-delà du réel ; sans eux, tout s’arrêtait finalement aux frontières de son propre corps, endolori, mortel.
C’est plein d’espoirs, un fantôme.
Quelle joie de savoir que quelque chose subsiste après la mort, quelle joie d’en avoir la preuve ultime ! Ainsi donc, nous continuons d’être, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour leurs descendants et les descendants de leurs descendants. La mort est inévitable et nous mourrons seuls, certes, mais la solitude est réservée à cet unique et bref instant de passage : ce qui nous attend ensuite c’est la félicité de graviter infiniment parmi nos semblables.
Hanter, c’est comme veiller sur les siens et sur sa propre mémoire. Car hanter, c’est déjà la volonté voire même l’obsession d’exister. Un obsession si forte qu’elle transcende toutes les règles du vivant et de son cycle incontournable. Rester, à tout prix. Les fantômes traînent leur présence brumeuse au cœur de nos vies, délaissés du poids de l’incarnation et des responsabilités qu’elle implique.
Ma tante aurait sans doute aimé être un fantôme. Pour elle, il n’y avait rien de plus souhaitable que de se débarrasser de son enveloppe charnelle. Devenir une essence, une âme, une image floue qui ne lui ressemblait plus mais qui ne l’empêcherait pas d’être reconnue par ses pairs. Exister, exister encore, ici et là à la fois, entourée à jamais par tous les revenants. Malgré son souhait, ils ont décidés un soir de partir, pour ne jamais réapparaître.
Il n’y a rien de plus déchirant que la promesse du fantôme.
Dans cette promesse, il y en a cent autres. Il y a celle du lien indéfectible entre les êtres qui s’aiment. Celle de l’amour plus fort que la mort. Des histoires qui continuent à s’écrire malgré la fin. Dans cette promesse, il y a l’apaisement, l’antidote aux adieux. L’assurance de pouvoir contempler, sans un mot, les traits de visages chaleureux qui ont adouci notre vie.
Je n’ai pas peur des fantômes, au contraire même, je les souhaite, je les rêve, je les appelle de tous mes vœux. J’étais plus jeune quand nous visitions ma tante à l’hospice, et son histoire n’a que gravé en moi l’espoir d’être toujours auprès des miens, même après leur décès. Cela a pu me faciliter la vie à bien des endroits, rendant le deuil inutile, mais aujourd’hui tout me pèse. Alors j’appelle mes fantômes, les fantômes des autres, les fantômes du futur même, peu m’importe. J’appelle et j’attends. J’attends leur réponse dans la hantise, j’attends leur manifestation pleine de non-dits.
Mais quand rien n’apparaît, quand aucun écho ne parvient, c’est là que la véritable horreur s’immisce. Si les fantômes existent, pourquoi certaines maisons sont-elles à jamais pleines de vie défunte, tandis que d’autres sont vides, emprisonnées dans la finitude du réel ? Pourquoi d’autres spectres hanteraient à loisir quand mes proches, eux, sont restés à jamais silencieux ? Dans tous les films les fantômes hurlent qu’ils sont là, juste là, mais chez moi, pas un murmure, pas un soupir, pas même l’once d’un début de possession. Je maudissais secrètement ce qui en moi-même m’avait rendu si plein d’espérance, et qui m’obligeait aujourd’hui à me poser cette question terrible : pourquoi mes parents n’avaient-ils pas eu envie de subsister près de moi ?
L’autre nuit j’ai fait le plus réconfortant des cauchemars : j’ai rêvé que j’étais possédé par ma tante. Mes doigts, crispés, ne pouvaient plus se refermer sur ma paume, désormais offerte à l’emprise intangible ; et je contemplais avec terreur cette main, qui semblait m’appartenir encore, mais qui répondait pourtant à une autre réalité que je ne me représentais pas. Ma nuque supportait comme un poids infime mais paralysant, m’obligeant à fixer, stupéfait, les mouvements répétitifs de mon pouce engourdi.
Pourquoi ce spectacle terrifiant avait-il à mes yeux du sens ? Pourquoi ces sensations m’étaient-elles familières ? Pourquoi ressentais-je constamment comme une chaleur absente au creux de mes mains ? Autour de moi il n’y avait rien, cependant ça me manquait encore.
En me réveillant, j’ai cherché partout les signes qu’ils étaient désormais à mes côtés : des objets jetés, des portes mystérieusement ouvertes, des messages transpirants sur des miroirs embués… Mais rien. Je me suis réveillé et je n’ai trouvé que le silence abyssal de l’inéluctable. Moi aussi, à présent, j’étais complètement seul.
Alors j’ai contemplé les ténèbres et leurs promesses de réconfort. Mais les promesses sont comme les fantômes : leur existence souligne l’absence de ce qui fût et l’impossibilité de ce qui devrait être.